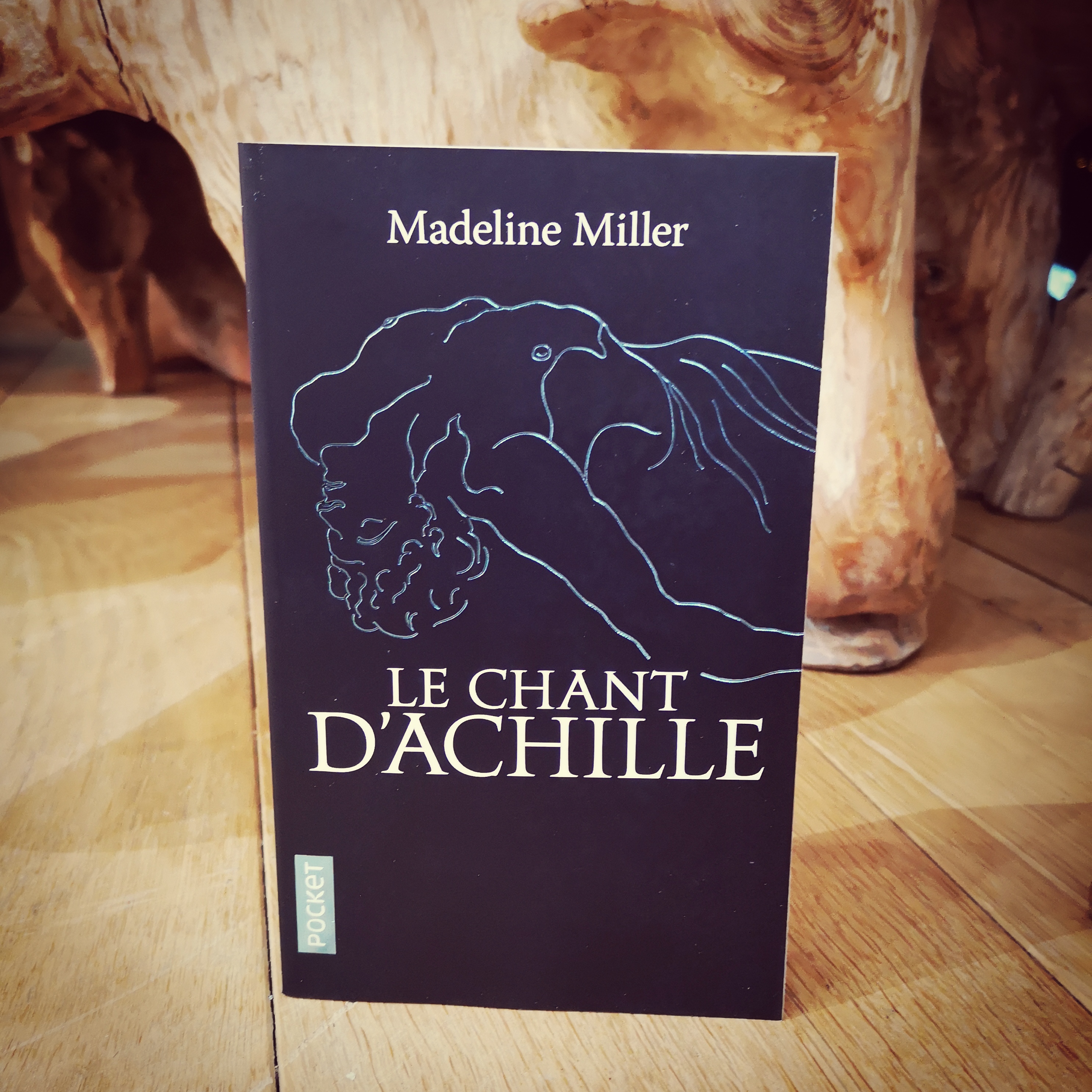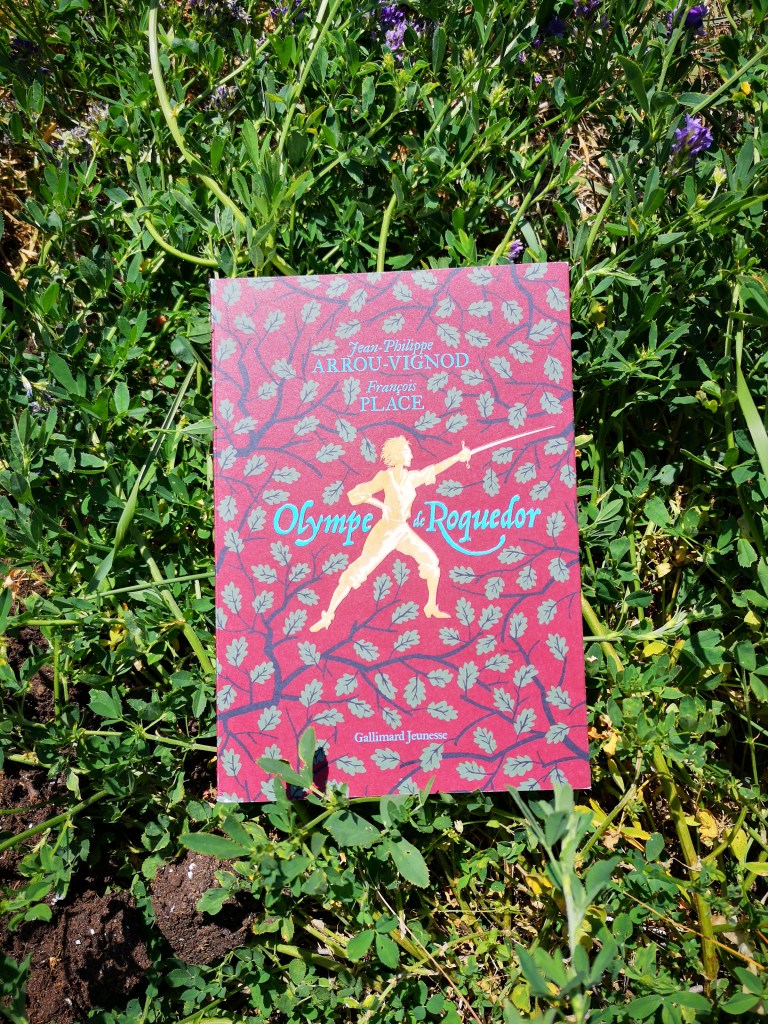Amis du jour, bonjour !
Je m’apprête à vous faire un retour de lecture qui risque de m’attirer les foudres de beaucoup d’entre vous. Je vous demanderai donc de prendre une grande inspiration et de bien lire ce que j’écris pour ne pas lancer un débat haineux que je n’aurai pas provoqué. Je préfère prévenir.
Le Pitch :
Nous sommes à Berlin, en 1942. Le père du jeune Bruno, 9 ans, se voit confier une importante mission qui les oblige, lui et sa famille, à déménager dans un endroit désolé, où les seuls enfants avec lesquels il pourra jouer sont de l’autre côté d’un étrange grillage…
Mon avis :
En dehors des textes de Sarah Cohen-Scali, je suis dans la totale incapacité de lire des textes qui se rapportent à la Shoah. La faute aux images d’archives qu’on nous montrait au collège et qui se sont imprimées sur ma rétine si puissamment que j’en ai encore des nausées. Je ne conçois pas la violence et l’inhumanité de ce qui a poussé les nazis à commettre de tels actes.
En revanche, ce texte-là, dont on m’avait dit qu’il me ferait verser toutes les larmes de mon corps, n’a réussi qu’à m’exaspérer et à déclencher, dans les derniers chapitres, une crise de panique. Sous couvert de la naïveté d’un enfant de 9 ans, des choses graves deviennent irritantes, sources de caprices (soupir, on se rappelle qu’on lit à hauteur d’enfant), et les mots sont déformés. Jamais Hitler ou Auschwitz ne sont correctement nommés. Eh, ce n’est pas parce qu’on ne peut pas nommer quelque chose qu’on ne peut pas comprendre son sérieux ou sa gravité. C’est sous-estimer l’intelligence émotionnelle des enfants.
Aussi, lorsque la naïveté va au-delà du bon sens, c’est cette intelligence d’un enfant de 9 ans que l’on insulte. Bruno, dans sa jeunesse, peut ne pas comprendre ce qu’il se passe, de même que son camarade, Shmuel, de l’autre côté des barbelés. Mais de là, à ne pas comprendre que l’un d’eux est du bon côté de la barrière, c’est franchement pousser très loin. On ne peut même pas parler d’un endoctrinement de l’enfant allemand (comme c’est le cas dans Max, de Cohen-Scali justement) puisque Bruno ne porte aucun amour au moustachu, ni aucune admiration au travail de son père. Il s’agit donc d’un môme sans le moindre discernement qui ne comprend pas la richesse, la pauvreté, la faim, la cruauté. Les enfants sont observateurs, ils comprennent bien plus que ce que l’on peut croire. Là, je vois surtout un adulte tenter d’avoir le regard d’un enfant et échouer lamentablement.
La fin, je la vois comme une sorte de revanche sadique. Elle dénote d’une cruauté simple, qui n’avait pour moi d’autre but que de choquer. John Boyne, irlandais de culture catholique (bien qu’ayant écrit des textes à charge contre l’Eglise), fait porter à Bruno, de manière invraisemblable, toute la culpabilité de ses pairs et met au pilori un gosse un peu bête. C’est cette espèce d’inversement de situation qui m’est insupportable, comme si faire subir à son prochain ce que l’on a subi soi-même (et encore, aucun auteur juif, que je sache, n’a mis d’allemand au four) pouvait montrer l’horreur. Ca ne la montre pas, ça la perpétue. C’est mon avis de personne peu éduquée sur le sujet, très isolé certes, sur ce texte que je ne recommanderai pas, parce qu’il n’enseigne rien, si ce n’est un pathos un peu facile, et le peu d’estime que l’on porte à l’intelligence enfantine.
Pour info :
éditions Gallimard Jeunesse (2006), collection Folio Junior, trad. de Catherine Gibert, 204 pages